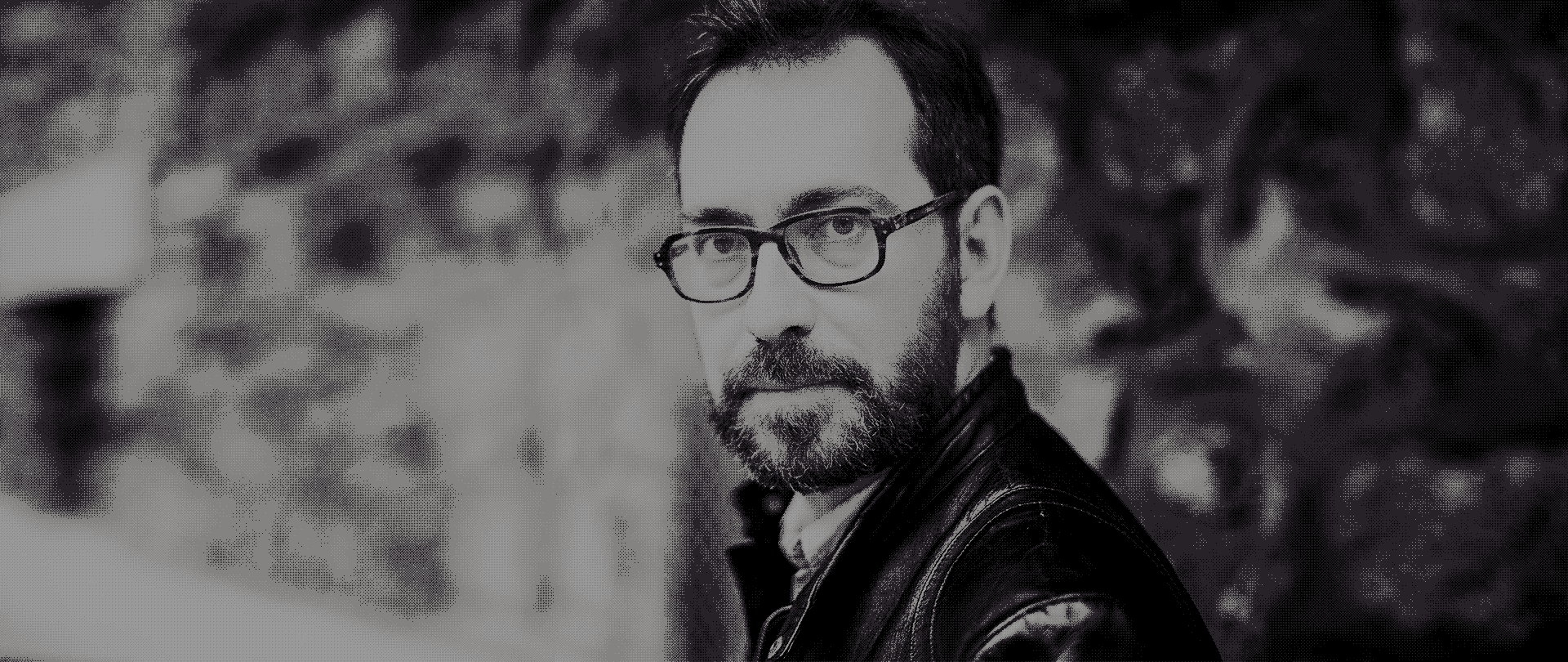« Continuer à penser le vivant comme une ressource est un énorme bug. »
Index
Chercheur à l’INRA et enseignant-chercheur en génomique animale à AgroParisTech, Thomas Heams veut chambouler notre regard sur le vivant. Dans son dernier livre « Infravies, le vivant sans frontières », ce spécialiste de biotechnologies ose la provocation pour défier la classification binaire entre vivant et non-vivant notamment en renonçant à continuer de donner du monde vivant une définition figée. Quand le chercheur anglais Nigel Thrift parle de « sentient city », Thomas Heams évoque l’Homme augmenté shooté aux sens.
Dans votre dernier ouvrage vous appelez à abolir les catégories et les périmètres du vivant comme si imposer une frontière avec le non-vivant serait un bug philosophique et même scientifique.Pourquoi ?
On constate depuis longtemps qu’il est difficile de donner une définition du vivant de manière convaincante par opposition au non-vivant. Il y a des entités qui restent un peu à la marge, par exemple les virus que l’on ne considère souvent pas comme vivants faute de métabolisme (même si c’est parfois contesté). Mais ils ont la capacité de se diviser et d’évoluer comme un être vivant.
Je me suis donc dit qu’il y avait d’autres manières d’imaginer cette définition, notamment envisager la vie comme étant un long mouvement adaptatif de la matière. La vie telle qu’on la connaît sur terre, constituée de cellules et d’ADN est une des formes que peut prendre cette mise en mouvement adaptative. Pour résumer la vie ne serait pas une catégorie dont il serait très difficile de définir le périmètre mais plutôt un état dynamique qui s’intensifierait progressivement.
Je pense que cette façon de penser pourrait être utile pour autre chose que la biologie. Ce travail de déconstruction des frontières pourrait s’appliquer dans les sciences sociales où la question des frontières entre genres est sensible par exemple. On pourrait aussi reconsidérer les frontières qui nous différencient des animaux… Je participe à un mouvement général de remise en cause des frontières comme critère de compréhension scientifique.
Quand vous affirmez que la vie n’existe pas, provoquez-vous sciemment pour faire bugger les codes classiques de pensées scientifique et philosophique, qui ont jusque-là cadré ces frontières ?
Oui je suis biologiste, la vie m’enthousiasme énormément et je suis content de pouvoir l’étudier. Quand je dis qu’elle n’existe pas je le dis de manière provocatrice en effet, précisant dans le livre qu’elle n’existe pas en tant que catégorie. C’est effectivement pour provoquer un bug de la pensée. Même la sémantique nous renvoie à l’équivalence problématique faite aujourd’hui entre le vivant et l’ordinateur, qui serait le dernier avatar du « vivant-machine ». On utilise un lexique informatique pour parler du vivant, par exemple avec le code génétique, les programmes génétiques et donc le bug. Dans le livre j’essaie aussi de déconstruire ce parallèle entre l’homme et la machine.
On arrive à des niveaux de technologie très élevés qui nourrissent la dystopie d’un futur dans lequel la machine sera plus forte que l’Homme et deviendra un être vivant capable de produire ce que seul un Homme peut produire aujourd’hui. Pensez-vous que ce soit un fantasme et est-ce que ces nouvelles technologies floutent déjà les frontières entre vivant et non-vivant, notamment dans ce qu’on appelle la « sentient city » ?
Je n’exclue pas la possibilité que l’on crée un jour une machine tellement puissante qu’elle se retourne contre les humains. Car nous sommes capables de concevoir des machines extrêmement puissantes. En revanche je ne pense pas qu’il serait pertinent de les qualifier de vivantes car justement elles ont un fonctionnement très déterministe que n’ont pas les êtres vivants. Même si par certains côtés elles disposent des caractéristiques assimilables au vivant. On n’imagine pas une machine se servir d’une fragilité pour devenir plus souple et plus adaptable or c’est l’une des caractéristiques inattendues du vivant. Les individus peuvent être très fragiles mais la vie possède cette capacité de résilience que n’a pas une machine.
Pour répondre à votre deuxième question, je pense qu’en intégrant tous ces objets connectés et tous ces systèmes de détection dans des smart cities capables de transformer des variations en données numériques, on pourrait en effet avoir l’impression que cela ressemble à ce que nous ressentons en tant que vivant à travers nos sens. On va transformer des molécules en odeur, des signaux lumineux en information visuelle et dans ce sens c’est un peu le même processus. Maintenant il faut garder à l’esprit qu’on peut tout faire faire à des algorithmes dès lors qu’on leur donne suffisamment de données pour travailler. Le résultat peut ressembler fortement à la logique humaine mais il ne faut pas oublier que cela reste un simulacre. Au final il s’agit d’une succession d’opérations logiques qui s’appliquent et au contraire de l’humain ou du vivant, l’imprévu n’y a pas sa place.
En tant que scientifique on imagine qu’il y a des règles de fonctionnement d’une population, or le vivant n’est pas que de la régularité. C’est une nuance qui a vraiment son importance car cela le différencie d’un algorithme. Cela dit, rendre des objets connectés plus sensibles à leur environnement est quelque chose qui trouve certainement son inspiration dans le vivant et dans cette caractéristique qui lui est propre : l’adaptabilité. Quand on s’adapte on reste le même, mais il y a un petit quelque chose en nous qui a changé et nous permet de maintenir notre pérennité. Ce constat introduit une question philosophique est assez fondamentale : que veut vraiment dire rester soi-même ?
Dans cette logique des « sentient cities », pensez-vous que l’Homme va créer un cadre d’exacerbation de ses sens ? Aujourd’hui il n’existe pas mais il pourrait demain réduire encore plus la frontière entre vivant et non-vivant !
Pour moi, vous parlez là de l’Homme augmenté. Du désir d’intégrer plus de données environnementales, via des prothèses ou des capteurs, par exemple pour détecter les infra-rouges en plus de notre information visuelle habituelle. La notion même de l’Homme augmenté implique que l’Homme actuel n’est pas plein. Qu’il est en partie vide. Cela légitime donc le projet du surhomme, charrie des espoirs mais surtout des craintes parce que cette thématique, depuis la mythologie jusqu’aux expériences tragiques du siècle dernier, est très ambivalente. Elle ouvre de nouveaux horizons et en même temps peut nous conduire à des extrémités épouvantables sur le plan social.
En outre, cette idée d’une exacerbation des sens repose sur une conception du vivant comme système auquel on pourrait greffer des modules additionnels, quasiment indépendants de ce qui préexiste. Et c’est étrange : nos sens ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres, ils sont interconnectés entre eux et avec l’environnement. C’est un travail évolutif et adaptatif qui ne s’est pas fait par ajouts successifs et on ne sait rien des conséquences en cascade qui résulteraient de l’intégration d’un module rajouté à notre équilibre corporel.
Si on se considère comme un petit ordinateur, alors il n’y a pas de problème, ce sont juste des data rajoutées dans un gros algorithme qui serait notre cerveau. Or ce n’est pas du tout le cas, notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur. Il ne calcule pas. On voit avec les smartphones qui nous bombardent d’informations toute la journée que cela peut nous faciliter la vie sur certains aspects ; mais aussi que cela peut pourrir notre façon de « relationner ». Il ne s’agit pas de tout rejeter ni d’être béat face à cela. Mais il faut comprendre que cela provoque des conséquences psychologiques et corporelles qui sont encore à étudier.
En envisageant une redéfinition des frontières entre vivant et non-vivant, y aura-t-il une période transitoire qui sera foncièrement un grand bug puisque nous allons devoir déconstruire pour reconstruire ?
Dans mon livre je fais une proposition qui n’est pas entièrement nouvelle puisqu’elle repose sur les publications scientifiques de mes collègues, que j’ai évidemment regardées avec un certain prisme. Est-ce que cette proposition peut être utile à la communauté biologique pour changer notre façon de penser le vivant ? Je pense qu’il y a de bonnes raisons à cela : on essaie de fabriquer la vie en laboratoire, on essaie de trouver la vie sur d’autres planètes, donc une façon plus ouverte de penser le vivant peut aider à ouvrir de nouvelles pistes d’expérimentation.En gros quand vous portez une idée perçue comme nouvelle, vous mettez votre discipline dans une situation de bouleversement. Je ne sais pas si on peut le qualifier de bug car c’est quelque chose qui arrive régulièrement dans l’histoire des disciplines. Cela peut provoquer un moment de tension, un moment de contradiction, bousculer des habitudes et des idées conservatrices. Réciproquement, on peut aussi vous démontrer que vous étiez un peu excessif, que vous avez poussé le bouchon un peu loin. Donc ce moment de tension peut être fécond, si l’idée est considérée comme pertinente par vos pairs, ils vont se rallier à ce nouveau paradigme, lui donner corps et le faire passer d’hypothèse à théorie. C’est peut-être un bug mais en tout cas, c’est le fonctionnement de la science tel qu’il existe depuis très longtemps.
Malheureusement nous assistons aujourd’hui sur le vivant à une course au sensationnel dans le monde de la recherche. De fait, elle bouscule un peu les frontières entre des faits et une promesse. Par exemple vous pouvez trouver de nombreuses publications titrées « on a créé la vie en laboratoire » alors que ce n’est pas encore le cas. C’est l’économie de la promesse : en écrivant l’article on fait le pari que cela va arriver, comme une prophétie auto-réalisatrice. Du coup quand vous amenez une idée nouvelle, elle tombe dans cet environnement complexe qui n’est pas celui d’il y a un siècle.
Est-ce que transhumanisme et bio-mimétisme sont aujourd’hui des leviers ou des socles fondamentaux de la redéfinition de la frontière entre vivant et non-vivant ?
Je suis sévère avec le transhumanisme parce qu’à mon avis, c’est une opération stratégique qui a été récupérée par la Silicon Valley pour brouiller justement les frontières entre ce qui est possible et ce qui est inepte. Quand vous promettez, par exemple, de lutter contre la mort en transférant la conscience des gens sur des ordinateurs, vous présupposez que la mémoire des ordinateurs a quelque chose en commun avec celle de l’humain. Or rien ne le démontre. Je pense qu’au mieux le transhumanisme est une imposture, au pire une idéologie inégalitaire servant l’intérêt des plus riches.
Le bio-mimétisme est lui riche de promesses à supposer que l’on sorte du 1.0 qui se contente de reproduire les performances d’un organisme. Moi j’aimerais un bio-mimétisme plus ouvert à l’originalité du vivant, qui n’est pas tant la performance qu’une interface entre de la fragilité et du désordre apparent.
Thomas, nous terminons cet entretien par l’épilogue traditionnel de Bug Me Tender. Quelle est votre définition personnelle du bug et dans votre domaine quel est le plus grand bug potentiel ou réel ?
Un bug c’est de l’imprévu dans un monde tristement prévisible. Et dans mon domaine, le plus grand bug c’est de continuer à penser le vivant comme une ressource et de se comporter comme une espèce qui pourrait épuiser cette ressource sans en voir sa diversité.